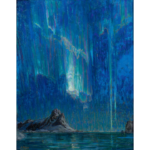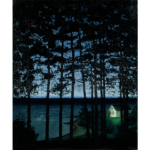Réunissant quelque 70 peintures de paysage exécutées entre 1880 et 1930, Lumières du Nord est un voyage dans les forêts boréales.
Un immense mur de LED posé sur la pelouse accueille le visiteur à la Fondation Beyeler : installation numérique signée Jakob Kudsk Steensen, Boreal Dreams est un monde virtuel questionnant le devenir d’un écosystème fragile, à l’aune de la crise climatique. Angoissant et envoûtant à la fois, ce prologue invite à considérer les paysages peuplant Lumières du Nord d’un autre œil. Au fil des salles – où sont proposées de mini-expositions monographiques – se déploient des œuvres (très) souvent méconnues, alors que leurs auteurs sont célèbres dans leur pays, à l’image de la Suédoise Anna Boberg. Explosions chromatiques d’une intense subtilité aux séductions magnétiques, ses Aurores boréales (sans date) se jouent d’une infinité de nuances de bleus pour rendre la magnificence des îles Lofoten. Puissamment mystiques, elles répondent aux vues du Canadien Lawren S. Harris, dans lesquelles la dimension spirituelle est essentielle. Pensons à Lake Superior (vers 1923) – dont les aplats et les formes élémentaires composent une scène pétrie d’une grande théâtralité, où le divin se manifeste – ou à Formes de montagne (vers 1926), qui tend vers l’abstraction.
Montrant une taïga souveraine et hostile, les toiles exposées sont le plus souvent vides de toute présence humaine. Les traces de pas traversant le colossal Neige fraîchement tombée (1909) du Suédois Gustaf Fjæstad – où il rend le paysage hivernal de sublime façon, entre blancs moutonnants et sourds violets – sont aussi inquiétantes que la petite cabane de pêcheur blanche, posée dans un coin d’Une Maison sur la côte (1906) du Norvégien Harald Sohlberg, est rassurante. Ce havre de paix irradiant d’une chaleureuse lumière est comme un phare installé au milieu d’une nature inhospitalière, écrasante et sombre, rendue de manière japonisante. Aucune toile ne montre néanmoins des éléments plus menaçants que Vampire dans la forêt (1924-25) d’Edvard Munch, où l’auteur du Cri donne une autre leçon d’épouvante. Dans son Tronc d’arbre jaune (1912), les grumes posées au sol au cœur d’une forêt de conifères questionnent la vie et la mort, dans le contraste entre l’orangé douceâtre des arbres abattus et le violet triomphant des écorces de ceux qui demeurent debout. Nos yeux contemporains y voient une critique de la déforestation, comme ils voient l’abstraction faisant irruption dans la figuration avec les cinq lignes dorées zébrant la gigantesque Cascade de Mäntykoski (1892-94) d’Akseli Gallen-Kallela. En réalité, elles sont les cordes d’un kantele, instrument traditionnel que seul Väinämöinen pouvait jouer dans le Kalevala, épopée finlandaise emblématique. Pour bucolique qu’elle soit, cette toile est ainsi avant tout un vecteur d’affirmation identitaire de la conscience nationale face à la domination russe, comme le furent les partitions de Sibelius, à la même époque.
À la Fondation Beyeler (Riehen / Bâle) jusqu’au 25 mai
fondationbeyeler.ch
> Devant la peinture Cascade de Mäntykoski, le visiteur peut entendre L’Épicéa de Jean Sibelius