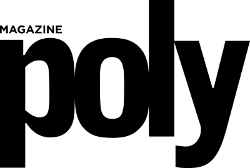Eva L’Hoest et la tech dans The Mindful Hand, à Luxembourg
Dans The Mindful Hand, Eva L’Hoest sonde notre relation ambiguë aux nouvelles technologies. De la mémoire vive à celle du vivant…
Après plus d’une trentaine d’expositions collectives, Eva L’Hoest signe enfin son premier solo institutionnel. Pour ce baptême du feu, elle s’empare de notre rapport aux outils d’imagerie analogique et numérique, disséquant leur impact sur l’expérience de vie humaine et sur l’opposition traditionnelle entre la main et l’esprit. La jeune Belge déploie un univers singulier surgissant d’entre les failles, où tout semble éternellement perfectible, entre erreurs (in)humaines et correction par l’expérience. Diplômée des Beaux-Arts de Liège en vidéographie, cette touche-à-tout se distingue par son approche sculpturale de l’image animée. Tel un zootrope, The Cave, the Cage, the Chorus donne l’illusion de l’animation en faisant défiler des bustes d’hommes modelés par l’IA. Renvoyant dos-à-dos le mouvement cinématographique et l’immobilisme statuaire, l’installation cinétique déconstruit la vision formée dans notre cerveau, pointant les limites de l’intellect. Inkstand – Fragments of intent appuie cette dialectique en contestant la supériorité de l’individu sur la machine. À sa manière d’emprunter la sinuosité et la vitalité d’un haut-relief de bronze, cette série de sculptures rappelle La Porte des Enfers de Rodin ; bien qu’affranchie des canons de beauté du 2e art, la Liégeoise puise en effet dans la tradition. Inspirée par les prémices du life casting (moulage sur nature), elle défie la conception romantique du geste créateur en mettant à nu les écueils de l’IA en tant que prolongement de l’activité humaine, terreau de la “mémoire” algorithmique. Rendue irréversible par la matérialisation, une simple erreur de calcul insuffle à l’oeuvre obtenue une dimension organique comparable à une anomalie génétique survenant dans la nature. « On pourrait s’attendre à une forme de standardisation aseptisée, mais un logiciel n’est pas infaillible. Cette part d’inattendu incite à reconsidérer ce qu’on croit unique chez l’Homme », observe l’artiste.
Pièce maîtresse de l’exposition, Ragdoll enfonce le clou avec humour. Imaginée à partir d’une modélisation de foule en 3D, cette sculpture est le fruit d’une superposition de photographies prises en un point de passage précis, accumulant plusieurs individus sur un même axe. Debout, ses multiples paires de bras et de jambes écartées, le protagoniste évoque un Homme de Vitruve 2.0. Si l’allégorie de Léonard de Vinci célèbre l’humanisme, cet Homo Numericus caricature l’apathie face à des systèmes dont l’intelligence se résume parfois à la confirmation de nos biais. « Le Ragdoll est une race de chat connue pour sa placidité semblable à celle d’une poupée de chiffon », commente la plasticienne, qui rajoute : « Nous nous laissons guider par les technologies sans les comprendre, au risque qu’elles nous enferment comme une boîte de Skinner », dispositif expérimental mis au point dans les années 1930 pour simplifier l’étude des mécanismes de conditionnement. Le cobaye n’est peut-être pas celui que l’on croit.
Au Casino Luxembourg (Luxembourg) jusqu’au 11 mai