En avoir ou pas
À 63 ans, Philippe Djian signe un roman sans répit, couronné du prix Interallié 2012, au féminin. Une première après une trentaine de livres et nouvelles, des dizaines de paroles pour Stéphane Eicher et quelques adaptations au cinéma. Rencontre autour d’ “Oh…” , entre Louis-Ferdinand Céline et Raymond Carver.
« Décembre est un mois où les hommes se saoulent – tuent, violent, se mettent en couple, reconnaissent des enfants qui ne sont pas les leurs, s’enfuient, gémissent, meurent… » Un extrait plutôt vendeur qui orne la quatrième de couverture de “Oh…”
D’habitude j’ai horreur des quatrième de couv’ et j’éprouve beaucoup de mal à résumer mes livres. Je n’aime pas expliquer les choses. Là, je trouvais que cela rendait bien l’humeur du roman. Pourtant l’extrait parle des hommes alors que c’est à travers les yeux d’une femme qu’on lit cette histoire. Ce doit être normal, je reste un homme et ne peut rendre l’idée d’un viol comme une femme. Je dépeins les mecs à un moment où ils sont très cons !
Il n’y en a pas un pour rattraper l’autre, même si ce ne sont pas que des bêtes et qu’ils sont capables de tendresse…
L’ex-mari du personnage principal passe quand même la nuit dans sa bagnole, devant sa maison, pour veiller sur elle après le viol qu’elle subit. Leur fils retourne habiter avec elle, ce qui les rapproche. Seul son amant ne descendra pas de sa connerie. Je connais tous nos travers masculins.
 Vous dites ne pas vous intéresser aux histoires qui ne sont que des prétextes à un travail sur la langue. Pourtant votre histoire est, ici, très forte !
Vous dites ne pas vous intéresser aux histoires qui ne sont que des prétextes à un travail sur la langue. Pourtant votre histoire est, ici, très forte !
C’est sûr. Mais j’adore cette phrase sur cette période de l’année complètement folle entre les fêtes. On peut être dans les pires emmerdes mais entre Noël et le Nouvel an, cela ne bouge plus. Tout peu arriver, surtout le pire. Un écrivain se pose des questions basiques. Par exemple l’été, vos personnages doivent partir en vacances alors qu’en décembre, on reste en famille. Mon intérêt pour la langue entraine peut-être un défaut : celui de faire des phrases que je trouve belles. Pas des phrases à la Proust, mais celles qui m’interpellent comme celle que vous citiez. Ce genre de choses ramassées. J’essaie de faire comme les auteurs que j’admire, qui ramassent le monde pour le foutre dans une phrase. Je cherche la coloration, la résonnance à l’oreille, la tenue actuelle. D’où mon emploi particulier des et cætera dont je me sers pour dire : voyez comment l’on pourrait déployer cette phrase et partir dans de longues subordonnées comme au XVIIe. Aujourd’hui, on ne peut aller au bout de ça alors on pose un “etc.” qui casse le rythme tout en appelant à plus. Nous ne sommes pas dans une révolution comme Céline en son temps, cassant la grammaire. Nous sommes dans un temps d’adaptation de la langue que l’on connait et qui n’est plus celle de mes 20 ans, en 1969, celle des Kerouac, Arthur Miller… La langue doit s’adapter à notre époque où un mec tue 70 personnes sur une île, où la technologie envahit tout, où les séries télé ont révolutionné le récit en apportant plusieurs noyaux centraux dans les histoires. Les gens sont habitués à rentrer par n’importe quel bout dans la fiction actuelle.
Vos ellipses temporelles et cet art d’aller à l’essentiel se rapprochent du rythme et des découpages des séries nord-américaines dont vous avez été l’un des premiers à vanter l’immense qualité il y a 10 ans…
Mon roman ne va pas si vite qu’on le croit, ce sont les ellipses qui donnent cette impression. Il se déroule sur 15 jours ou un mois. C’est son découpage global qui crée cet effet, mais aussi celui de la phrase.
 Comment cela s’est-il imposé à vous ? C’est une volonté qui prédomine avant même de penser à une histoire ?
Comment cela s’est-il imposé à vous ? C’est une volonté qui prédomine avant même de penser à une histoire ?
Les dix premières phrases que j’ai écrites ont été publiées. Je sentais qu’écrire m’intéressait, le reste (structure, travail, intrigue…) vient avec, comme un road-movie. Je n’avais aucun recul sur mes écrits car je n’avais pas une ligne en stock, pas un manuscrit dans un tiroir. J’ai du faire mon apprentissage et laver mon linge sale devant tout le monde, évoluant de livre en livre. J’ai l’impression qu’ils se tiennent comme des wagons, ayant tous quelque chose en commun. Si les histoires m’intéressent de moins en moins, c’est que seule la langue est une chose à laquelle consacrer sa vie, pas écrire des histoires.
Pourtant on retrouve les questions du couple et de ses aléas, la parentalité, la vieillesse et d’autres thèmes dans chacun de vos livres…
La haine, l’amour, la séduction sont communs à tous les hommes depuis toujours. Shakespeare a déjà tout écrit ! Sauf que certains, comme le cinéaste japonais Ozu, sont capables de décentrer les choses. En posant sa caméra par terre, on ne voit pas les choses de la même manière. En littérature, c’est la langue qu’il faut décentrer pour provoquer ce genre de choses, donner à voir autrement des choses déjà racontées par d’autres. Tout est affaire de séduction, de besoin d’amour. On le voit bien avec nos politiques : Sarkozy ne demandait que ça ! Aimez-moi, bouffez-moi, baisez-moi ! Nous n’inventons rien, d’autant que les codes sont très, voire trop, pesants en France. Il m’a fallu lutter pour imposer de ne pas faire de retrait à la ligne à chaque paragraphe ou chapitre. Je ne voulais pas mettre le lecteur en position de confort, comme Wagner ne voulant pas que le public soit bien assis à Bayreuth. L’art n’est pas fait pour ça.
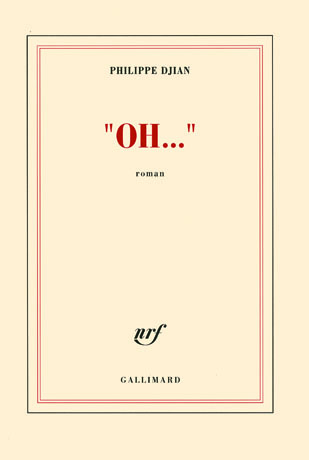 Comment ressortez-vous de cette histoire sur la douleur mêlée au plaisir, sur l’attirance d’une femme pour quelque chose qui la détruit ?
Comment ressortez-vous de cette histoire sur la douleur mêlée au plaisir, sur l’attirance d’une femme pour quelque chose qui la détruit ?
Si une femme me racontait cette histoire, je pense que je la comprendrais. Elle est belle, vieillit et doit se sentir capable d’être folle pour ne pas se sentir glisser vers le troisième âge. Elle est attirée par son voisin qui est son violeur. On peut être choqué, mais au final, elle ne fait rien de mal. Les sentiments humains sont faits de complexité qu’il faut tenter de comprendre. Jeter la première pierre est bien trop facile. Je crois que nous sommes meilleurs à l’intérieur que ce qu’on montre à l’extérieur.
Qu’est que ça fait d’écrire depuis 30 ans ?
Je suis fier d’avoir trouvé qu’il fallait me mettre au service de ma langue. Céline disait que « si vous voulez des histoires, achetez les journaux, ils en sont pleins ! »
Est-il toujours abominable d’écrire, chaque matin, pour vous ?
Oui mais cela ne m’est pas imposé. Si je me fais mal, c’est que j’aime bien cela. Il y a toujours eu très peu de ratures dans mes manuscrits. En fait, je tapais très mal à la machine et ne voulais pas m’emmerder à retaper toute une page pour une connerie écrite à la fin. Du coup, je me forçais à penser ma phrase avant de l’écrire et j’abolissais tout interligne et toute marge afin de ne pouvoir revenir dessus une fois tapée. Cela venait de la peur que tout s’arrête pendant que j’écris et qu’on lise au-dessus de mon épaule ma dernière phrase. Je ne voulais pas qu’on se dise qu’elle ne soit pas bonne. Je pense toujours que c’est la dernière phrase que j’écris. J’essaie encore plus qu’avant d’aimer chacune de mes phrases. Mais la préciosité est le vice de l’écrivain. Il ne faut pas que ce soit trop bien, trop beau comme Nabokov que j’adore au demeurant.
Quel est le rôle de l’écrivain dans la société ?
L’écrivain a une place importante dans la société. Les gens se servent de la langue pour communiquer. Les gens en viennent aux mains quand ils sont au bout des mots. Là, j’ai un travail à faire, une langue à proposer, qui ne soit pas compassée comme celle de Proust qui ne peut servir qu’à des groupes d’érudits fumant dans des fauteuils Cotton Club, mais ça ne sert pas au mec de la rue. Je ne suis jamais allé vers la littérature pour une visée esthétique. J’attendais des écrivains que je lisais qu’ils m’apprennent à me comporter dans la vie. Raymond Carver m’a appris à traverser la rue, bien mieux que si je n’avais lu que Marc Lévy. Si je peux faire ça en tant qu’écrivain, je veux bien y passer 30 ans et jouer ce rôle là.

