Interview // Alain Mabanckou entre ombres et lumières
Du retour en 2012 dans son Congo natal, vingt-trois ans après son départ pour l’Europe, Alain Mabanckou tire Lumières de Pointe-Noire. Un carnet de voyage autobiographique, confrontation intime d’un émigré avec les siens, ode dénuée de cynisme à une Afrique mystique et traditionnelle. Interview.
Comment l’idée de ce livre s’est-elle imposée ? Avant même ce retour au pays ?
Plutôt pendant que j’y étais, pour donner des conférences et rencontrer le public de Pointe-Noire, discuter avec ces jeunes qui me lisaient depuis des années. Mais dès mon arrivée dans ma ville d’origine, j’ai senti qu’il y avait quelque chose qui allait se faire, qu’un livre s’y préparerait. Je m’étais dit que si une nostalgie d’enfance naissait, j’en ferai peut-être quelque chose de retour en France ou aux États-Unis. Je pressentais bien que je ne sortirai pas indemne de ce voyage.
Les feuilles de cahiers d’écoliers que vous avez noircies, jetées à la poubelle avant d’être défroissées le lendemain que vous racontez avoir ramenées dans une valise et intégrées au manuscrit sont toujours en votre possession ?
Ces brouillons sont très importants pour moi. Je le disais aux jeunes m’interrogeant là-bas : j’ai énormément déchirés les pages que j’écrivais. Maintenant je les froisse et je les garde car, souvent, c’est dans le brouillon que se trouve la vraie force de ce qu’on a pensé, la vraie parole telle qu’elle est advenue. J’ai donc conservé ces pages manuscrites mais aussi d’autres, en notes, dans mon téléphone.
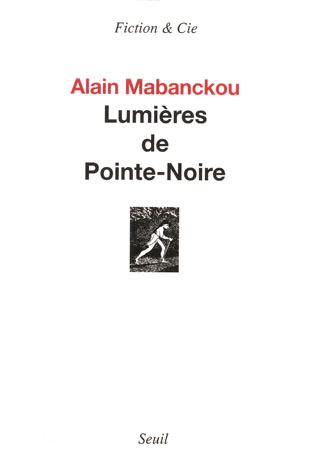 On sent dans Lumières de Pointe-Noire que vous avez jeté des choses qui ne vous plaisaient pas mais aussi que vous n’aviez pas envie de lire à ce moment là. En les reprenant, c’est comme si vous retrouviez de vous-même la pureté première des sentiments de l’instant…
On sent dans Lumières de Pointe-Noire que vous avez jeté des choses qui ne vous plaisaient pas mais aussi que vous n’aviez pas envie de lire à ce moment là. En les reprenant, c’est comme si vous retrouviez de vous-même la pureté première des sentiments de l’instant…
Tout à fait. En les froissant, j’exprime mon insatisfaction, comme si ce n’était pas la vraie peinture des choses, la parole juste. En les reprenant dans la poubelle le lendemain, j’avais l’impression que j’étais le mauvais juge de ce qui s’était passé et de l’efficacité de ce que j’avais écrit dans l’instant, comme ces aliments qui doivent être laissés de coté pour mûrir avant d’être consommés. L’écriture instantanée et immédiate bousculait ma manière de faire car j’ai l’habitude de prendre le temps. Je devais passer cela à la moulinette, remettre en question mon jugement et la qualité de ce que j’avais consigné.
Maintenant que vous avez Lumières de Pointe-Noire en main, quel bilan tirez-vous de ce retour sur votre passé et dans votre pays après 23 années d’absence ?
Une sorte de sérénité. Des choses de cette ville ne peuvent être vues par personne d’autre que moi car j’ai gardé une photographie d’une époque ancienne qui n’était pas celle de la couleur, qui est venue pervertir les choses. L’inattendu de mon voyage est parfait, comme le fait qu’il n’ait pas eu ce livre pour projet. Le bilan est celui d’un soulagement, d’un travail qui pourrait continuer parce qu’on n’a jamais finit de décrire la lumière. Il y en a surement d’autres à Pointe-Noire.
Le livre débute sur une ode à votre mère disparue et nombreux sont les critiques à avoir mis en avant la place des femmes. Pourtant, les figures masculines et la trilogie de pères qui vont a accompagnée est presque plus touchante car vous donnez l’impression de la redécouvrir…
Vous faites bien de le souligner car la tendance est réelle. La place des hommes est étrange avec mon oncle Matété me mettant dans un côté mystique en recueillant mes urines pour les déverser dans la brousse, le Grand Poupy séducteur, le tonton Mompéro… Au fond le livre est équilibré en genres : les femmes sont magnifiées avec la figure de ma mère, mais il y aussi Bienvenuë qui est à l’hôpital ou encore Georgette. L’équilibre est social. Les hommes ont des figures romanesques fortes et l’équilibre est ainsi respecté. Mes autres romans faisaient grande place aux hommes comme Verre cassé, racontant les frasques d’un homme où la femme est toujours en position désavantageuse, Black Bazar sur un séducteur… Ici, les femmes ont compris que pour être l’égale des hommes, elles devaient l’attaquer sur ce qu’il exhibe comme son tribut : l’indépendance ou l’activité professionnelle, ce qui fâche mon propre père qui pense que s’il n’est pas le propriétaire de la parcelle achetée par ma mère, il y est comme locataire !
Que produit cet écart entre votre vie pour partie aux États-Unis et en France et le côté mystique et traditionnel retrouvé au Congo ?
J’ai intérêt à garder cette innocence, cette croyance en un côté mystique et fantastique, ce qui peut paraître aberrant en occident où la raison l’emporte sur l’intuition. J’essaie de garder cette fibre, ce côté mystérieux des choses où ce n’est pas seulement le coté physique qui détermine l’existence. Aux États-Unis, j’essaie de garder la virginité du rêve d’enfance qui consiste à croire qu’il y a peut-être quelque part un deuxième monde des possibles où l’on peut déplacer des montagnes et où les gens n’ont pas besoin de prendre l’avion mais seulement d’écarter les mains pour s’envoler. Le ciel est si bas qu’il suffit d’enlever quelques nuages d’un coup de bras, les rivières coulent dans les deux sens… Il y a une sorte de magie que je conserve et c’est sûrement ce qui m’a poussé dans les bras de l’écriture : le fait de croire qu’il y a une innocence dans le côté mystique des choses qui explique le monde.

La fin du livre est entrecoupée de témoignages assez engagés sur les prostituées du Quartier des trois-cents, sur le rôle joué par l’Angola et la France dans la guerre civile … C’était un besoin de parler du Congo alors même que son voisin, la RDC (ex-Zaïre), a toujours tiré la couverture à lui en France ?
Ces sujets s’imposaient dans la ville. À proximité du quartier des prostituées, on sent l’histoire et le malaise sous-jacent. De même lorsque vous croisez des Congolais, vous sentez les stigmates et les marques des guerres civiles passées. Quand j’arrive, les gens veulent m’en parler. Cette prostituée se faisant appeler Madame Claude pour conserver l’anonymat veut que son calvaire soit entendu jusqu’en Europe : des hommes font pression sur elle et ses consœurs pour avoir des relations tarifées sans préservatif. De la même manière, celui qui se prétend rescapé de la guerre civile mais qui est en réalité un escroc, profite que le pays ait été en guerre pour se faire passer pour l’une de ses victimes et ainsi avoir des repas gratuits au restaurant. Cela rentre dans ce que j’appelle les nouvelles mythologies de Pointe-Noire : au début du livre elles sont fondées sur les ancêtres et les traditions. Ensuite, elles sont comme ce qu’on appelle aux États-Unis les légendes urbaines où les femmes créent une mythologie contemporaine née avec l’urbanisation consistant à justifier un statut de prostituée, où pour escroquer son monde à en recréant une histoire dans l’histoire de la guerre congolaise. Les mythologies sont arrivées avec le Cinéma Rex, lui-même remplacé par une église évangéliste et, donc, de nouvelles mythologies.
Vous faites preuve d’une absence remarquable de misérabilisme, notamment lorsque vous reprenez de volée un ami venant de France prenant les gens de haut. On sent que vous avez eu besoin de vous réadapter à la notion de « la famille » à l’Africaine avec des dizaines de neveux plus ou moins éloignés, sans pour autant tomber dans un regard d’occidental…
J’avais peur de cela en retournant là-bas, de me comporter en Européen car j’ai désormais passé plus de temps ici que là-bas. Ce laps de temps a-t-il changé mes perceptions au point que je verrai les richesses sous le prisme de la civilisation occidentale ? Ces enfants qui sont mes neveux m’ont donné en quelque sorte l’exemple même du bonheur : ils se contentent de peu, ne veulent pas beaucoup plus, leur verre est petit mais ils boivent dans leur verre. Évidemment, certains Congolais arrivent, bardés de leur expérience européenne en disant que tous ces enfants vivent dehors, dans la misère, mais parce que dans ce que l’autre conçoit comme la misère de la jeunesse africaine, ces enfants recherchent les plaisirs dans des détails qui passent inaperçus pour les autres : le plat qui fume, les cerceaux, les tongs, la chemise ouverte en courant… une certaine esthétique du bonheur dont je suis fier d’avoir gardé la ligne. J’étais heureux d’être au milieu d’eux parce qu’ils étaient ce que j’étais à l’époque.
Demain j’aurai vingt ans et Lumières de Pointe-Noire m’apparaissent comme deux faces d’une même pièce. C’est votre sentiment ?
Je les vois comme deux livres qui se regardent. Dans Demain j’aurai vingt ans, il y a la voix de ce petit enfant qui est censée être la mienne, j’ai essayé de m’en souvenir pour laisser le petit garçon en moi parler de mon enfance. De ce fait, il fallait convoquer l’innocence et l’ironie. Dans Lumières de Pointe-Noire, c’est l’adulte qui vient en spectateur, regarde cet enfant au milieu de cette famille. Il se tait pour laisser parler les personnages. Ils forment un diptyque et l’on peut, comme vous le dites, les apposer. Parfois, on peut avoir l’impression qu’ils se mélangent. J’ai essayé, avec la même matière, d’écrire deux livres aux apparences presque identiques mais en vérité forts différents. Il y a plus de gravité et de confidence dans Lumières de Pointe-Noire, contrastant avec la liberté d’expression de Demain j’aurai vingt ans.
 A-t-il été difficile de se retrouver dans la peau du membre de la famille qui vit à l’étranger et qui revient ?
A-t-il été difficile de se retrouver dans la peau du membre de la famille qui vit à l’étranger et qui revient ?
En tant qu’émigré, ils imaginent que l’on revient avec des richesses. C’était une situation difficile mais tant que j’avais quelque chose et que je pouvais satisfaire quelqu’un, je le faisais parce que je n’ai jamais accordé beaucoup de crédit à la recherche matérielle. Et ce que ces gens me donnent dépasse toutes les fortunes que je pourrais accumuler, ce sont les personnages de mes romans. Ce sont eux qui ont fait qu’ils existent. Je pense qu’ils se trompent sur la créance qu’ils réclament ! Au lieu de demander le remboursement de funérailles, l’achat d’une chemise ou autre, ils auraient pu me demander le retour de cela. J’aurais alors été bien embêté.
Quand vous recevez les jeunes auteurs de Pointe-Noire qui veulent absolument vous lire leurs manuscrits, l’un d’eux vous demande pourquoi vous écrivez. Avec une pirouette vous esquivez la question. Aurais-je plus de chance ?
C’est très difficile de répondre à cette question et c’est peut-être ce qui fait que l’on continue à écrire. On sait bien qu’on n’aura jamais la véritable justification mais ce livre contribue à expliquer pourquoi on continue d’écrire. À sa fin, on peut se dire que c’est normal, avec une vie comme celle-là, de devenir écrivain. Je pense même que la difficulté de le définir est comme une charge mais aussi comme un soulagement d’être dans l’écriture parce que pendant longtemps j’ai été presque obligé de m’inventer un monde autre que celui en face de moi pour me sentir plus à l’aise. M’inventer des sœurs imaginaires comme je le raconte dans le livre était un moyen de naviguer entre réalité et fiction. On écrit donc pour être en sécurité. On écrit parce qu’on se sent en insécurité dans le monde réel. On écrit parce qu’on se dit que, puisque ce monde dans lequel on vit ici-bas ne nous plait pas, on ne peut intervenir et on ne m’entend pas, alors autant créer un monde où organiser la vie, les personnages, les lieux, les dialogues… Au moins j’aurai la force de gouverner ce monde car c’est le mien. Si on m’embête dans le réel, je retourne dans le mien, c’est-à-dire celui de l’écriture.

